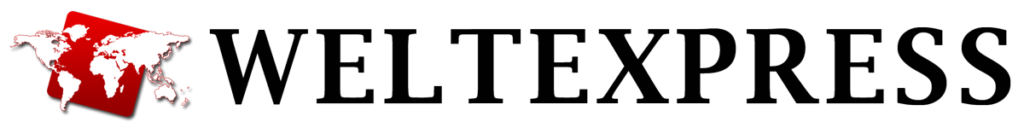Berlin, Allemagne (Weltexpress). J’ai écrit le texte suivant en 2017 et l’ai publié sur mon blog. Depuis, on tente de masquer le vide décrit par davantage de phrases creuses, tandis que les fondations continuent de s’effriter. Réflexions pour Pâques.
Cette année, Pâques a été étrangement vide. Mes filles sont désormais trop grandes pour peindre des œufs ; j’ai pensé qu’il était temps de me pencher sur ce mythe (et les mythes similaires qui l’entourent) et j’ai cherché une introduction simple dans le programme télévisé, mais j’ai constaté avec étonnement que Pâques n’avait plus rien à voir avec Pâques.
Nous sommes athées, et on pourrait penser que ce vide me réjouit. Quand il s’agit des querelles qui ont lieu dans l’espace public, par exemple sur la question de savoir si « La vie de Brian » peut être projeté au cinéma le Vendredi saint, ma position est claire ; il en va de même pour les croix dans les bâtiments publics. Mais cela ne me réjouit pas ; je y vois le signe d’un vide plus profond et menaçant.
J’aurais aimé discuter avec mes filles de ce qui rend une vie humaine significative, voire précieuse, au-delà de la consommation ; après tout, se poser ce genre de questions est une tâche classique pour les adolescents ; mais j’ai constaté que le discours culturel véhiculé par les médias ne laisse aucune place à cela. Autrefois, la période précédant Noël et Pâques constituait au moins une interruption temporaire dans le silence ambiant sur les questions sociales, et il y avait une tendance à reconnaître que le quotidien ordinaire n’était pas tout ce qui définissait ou devrait définir l’être humain. Même cette petite fenêtre s’est désormais refermée.
De telles irritations m’incitent toujours à creuser plus loin. Pourquoi le vide de ces jours fériés me rend-il tout sauf heureux ? Que me manque-t-il dans une Pâques sans Pâques ? Est-ce la résistance qui se dégage de l’histoire de Pâques ?
Non, c’est autre chose, et le vide est plus profond, il touche aux fondements mêmes de la société humaine.
Pour expliquer ce que j’ai découvert, je dois d’abord clarifier une imprécision linguistique de l’allemand. L’allemand désigne par le même mot « Opfer » (sacrifice) les notions que l’anglais distingue en « victim » (victime involontaire) et « sacrifice » (sacrifice volontaire) (en latin, ces termes sont également distincts). Je tiens donc à préciser d’emblée qu’il s’agit ici du concept de sacrifice volontaire. C’est le cœur du récit pascal, mais aussi le cœur du comportement rituel qui y est associé (pendant le carême). Cette image du sacrifice est en train de disparaître et d’être remplacée par une vision du monde qui ne connaît plus que des auteurs et des victimes (au sens de « victim »). Cela apparaît clairement non seulement dans les récits de la culture quotidienne, mais aussi dans le langage des jeunes, parmi lesquels « tu es une victime » est considéré comme une insulte.
« John Maynard était notre timonier,
il a tenu bon jusqu’à ce qu’il atteigne la rive,
il nous a sauvés, il porte la couronne,
il est mort pour nous, notre amour est sa récompense.
John Maynard » (Theodor Fontane)
Chaque culture connaît de telles histoires héroïques ; la bourgeoisie du XIXe siècle les connaissait encore, comme le prouve le poème de Fontane. Pour les trouver, il n’est pas nécessaire de se plonger dans l’histoire des guerres et de se remémorer la bataille des Thermopyles. Bien sûr, ces images et ces mythes sont parfois détournés, mais ils sont fondamentaux pour toute culture humaine, et le comportement qu’ils érigent en idéal est en réalité une condition préalable à la survie en tant que groupe ou en tant qu’espèce dans les situations les plus diverses.
La culture humaine repose sur la coopération, et le sacrifice n’est rien d’autre qu’une forme extrême de coopération. Le fait que les récits de sacrifices soient rappelés de différentes manières est en même temps une affirmation de la coopération, fondement de l’existence humaine.
Il existe une série d’expériences menées en 2012 par la Société Max Planck d’anthropologie évolutionnaire qui est très intéressante. Ils ont donné à des primates et à des enfants en bas âge une tâche à accomplir ensemble et ont observé le comportement des uns et des autres face à la récompense. Chez les primates, la coopération a permis de résoudre la tâche, mais ensuite, chaque singe a cherché à s’assurer la plus grande part possible de la récompense. Chez les enfants en bas âge, âgés de deux à trois ans, un changement radical s’est produit : les enfants de trois ans ont veillé à partager la récompense. Ils avaient une notion de justice qui guidait leurs actions.
Cette différence de comportement a des conséquences importantes. L’égoïsme des singes anthropoïdes a pour conséquence que la coopération n’est possible qu’à court terme, pour un problème unique. Ils peuvent reconnaître la nécessité de coopérer, mais ils ne peuvent pas la maintenir. Les enfants humains considèrent la coopération comme une nécessité fondamentale et permanente ; ce n’est que si le résultat est partagé équitablement que les participants continueront à coopérer.
Ce comportement résulte du fait que le développement de la culture humaine, voire la survie même de l’espèce, n’a été et n’est possible que grâce à une coopération durable. De nombreux traits que nous considérons comme caractéristiques de l’être humain se retrouvent également chez nos plus proches parents : ils font la guerre et fabriquent des outils. Mais il existe une différence décisive qui nous a permis d’accumuler et de transmettre des connaissances et des compétences au fil des millénaires : la capacité à coopérer. Et il n’est pas anodin que les concepts de justice et de coopération soient si étroitement liés…
La culture naît lorsque la coopération dépasse la durée de vie d’un individu. Lorsque les connaissances acquises par certains sont transmises, au moins en partie, à la génération suivante et constituent la base de son développement. Einstein a dit un jour qu’il était un nain sur les épaules d’un géant, faisant référence à Isaac Newton. Mais même Newton est un nain qui se tient sur les épaules du géant inconnu qui a inventé la roue. Cette longue chaîne de partage est notre force, celle qui nous a conduits jusqu’à l’espace.
Cette nécessité de coopérer peut également dépasser la durée d’une vie individuelle à d’autres égards, comme dans le poème de Fontane. Il existe des situations dans lesquelles le bien-être de la collectivité (qui peut parfois englober l’humanité tout entière) dépend de la prise de conscience par les individus que leur bien-être personnel est insignifiant dans l’ensemble. Dans l’histoire de Pâques, cela peut être fictif, mais c’est précisément à ce niveau que l’on observe de profondes fissures dans notre société occidentale capitaliste.
« La chose la plus précieuse que possède l’homme, c’est la vie. Elle ne lui est donnée qu’une fois, et il doit l’utiliser de telle sorte que plus tard, il ne regrette pas amèrement d’avoir gaspillé des années, que la honte d’un passé indigne et vain ne l’accable pas et qu’il puisse dire en mourant : « J’ai consacré toute ma vie, toute mon énergie à la plus belle chose qui soit au monde : la lutte pour la libération de l’humanité. » (Nikolaï Ostrovski)
Si l’on compare les deux grandes catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, il existe une différence décisive. À Tchernobyl, la réaction en chaîne a été stoppée, à Fukushima, trois cœurs fondus sont toujours réactifs.
La différence technique réside dans le fait qu’à Tchernobyl, en réaction à l’explosion du réacteur, des tonnes de bore ont été déversées par hélicoptère sur la masse incandescente. Le bore, lorsqu’il fusionne avec la lave atomique, freine la réaction en chaîne qui n’est plus ralentie par l’eau et permet à la lave de refroidir et de se solidifier. C’est la seule raison pour laquelle il a été possible, à Tchernobyl, d’empêcher la propagation des substances radioactives à l’aide d’un sarcophage en béton. Un cœur fondu qui reste réactif continue de fondre dans le sol (phénomène connu sous le nom de « syndrome chinois ») et peut disperser de nouveaux produits de fission dans l’environnement via les eaux souterraines. C’est ce qui se passe encore aujourd’hui à Fukushima.
À Fukushima, il aurait fallu faire sauter l’enceinte interne et injecter massivement du bore, comme à Tchernobyl.
Les pilotes d’hélicoptère de Tchernobyl ont toutefois payé leur intervention de leur vie, comme beaucoup d’autres qui ont contribué à endiguer la catastrophe. La vidéo suivante en est un exemple (et une occasion de commémorer leur sacrifice) :
Le récit de Tchernobyl ici en Occident a toujours affirmé haut et fort que tous ceux qui ont aidé à lutter contre la catastrophe en Union soviétique ne savaient pas dans quel danger ils se mettaient et avaient été sacrifiés par leur gouvernement sans scrupules. Ils étaient donc des victimes au sens anglais du terme, et non des héros. Cependant, la formation scientifique était bien meilleure en Union soviétique que chez nous. J’ai obtenu mon baccalauréat en 1981 et je n’ai des connaissances précises sur les centrales nucléaires que parce que j’avais suivi un cours de chimie approfondi. Non seulement les élèves des collèges et lycées professionnels, mais aussi la plupart des lycéens n’apprenaient tout simplement rien à ce sujet. En RDA, ce sujet était enseigné en classe de troisième…
L’histoire de leur engagement se lit tout autrement lorsque la victime involontaire est remplacée par une victime volontaire, comme le raconte la vidéo ci-dessus. Non seulement parce que cela soulève alors la question de savoir si nous ne devrions pas être reconnaissants envers ces personnes, ici aussi, mais aussi parce que cela soulève une autre question : trouverions-nous dans notre société un nombre suffisant de personnes prêtes à faire ce sacrifice ?
Fukushima a répondu à cette question. Il n’y en a pas.
Même le gouvernement japonais de l’époque n’a pas trouvé le courage de nationaliser immédiatement l’entreprise Tepco afin de lutter contre une catastrophe nationale en tant que nation et, par exemple, de faire appel aux pilotes qui s’étaient engagés, du moins en théorie, à être prêts à faire un tel sacrifice, à savoir les pilotes d’hélicoptère de l’armée de l’air. Non, le gouvernement voulait avoir le moins possible à voir avec toute cette affaire, et rares sont ceux qui seraient prêts à sacrifier leur vie pour une entreprise ; cette idée est absurde. En conséquence, jusqu’à aujourd’hui et pour une durée indéterminée, ces trois cœurs fondus, toujours réactifs (la réaction en chaîne qui se poursuit maintient les cœurs chauds et liquides), continuent de rejeter des matières radioactives dans l’océan Pacifique. Les conséquences pour l’humanité tout entière sont encore impossibles à évaluer aujourd’hui…
Oui, le risque de cette forme spécifique de catastrophe est d’origine humaine. Mais toute société humaine est exposée à des risques de catastrophes de toutes sortes, et sa capacité à y faire face détermine sa survie physique. Sur ce point, l’Union soviétique possédait une force que notre société n’a pas.
« La société n’existe pas. » (Maggie Thatcher)
La société humaine évolue vers des niveaux de coopération toujours plus élevés, dans des espaces et des contextes toujours plus vastes. L’historiographie marxiste appelle cela le développement des forces productives. Aujourd’hui, la coopération a atteint des proportions inimaginables (comme le montre par exemple le documentaire « Weltfabrik ») et est sur le point de franchir une nouvelle étape importante avec ce qu’on appelle « l’industrie 4.0 ». Mais cette coopération se fait de manière inconsciente, les producteurs impliqués ne savent pas jusqu’où elle s’étend ni avec qui ils collaborent, ils le font involontairement. La conscience quotidienne, qui met l’accent sur la concurrence de chacun contre tous, évolue dans la direction opposée. Ou est développée dans la direction opposée.
La coopération étant essentielle à la survie de notre espèce, le système psychique de l’être humain s’est développé en conséquence. Agir ensemble est plus agréable que d’agir seul, la reconnaissance est vécue plus positivement que la récompense matérielle, et une action jugée utile est plus satisfaisante qu’une action absurde. La guerre de tous contre tous est une violation permanente de cette structure. Même pour développer un sentiment d’identité, nous avons besoin de l’autre, du groupe ; on nous propose « Deutschland sucht den Supermodel » (l’Allemagne cherche le top model) et le rêve, inaccessible pour la plupart, d’une consommation illimitée.
Ce qui était au début de la société bourgeoise la recherche du bonheur (pursuit of happiness, en fait le bonheur au sens de satisfaction durable) est aujourd’hui la recherche de la possession, le véritable idéal de la société actuelle. Comme la satisfaction des besoins réels n’est pas possible ou n’est pas opportune (si tout le monde avait par exemple des logements abordables, les gens seraient moins dociles), mais que la machine de production a besoin de débouchés, d’innombrables besoins faux doivent être inventés et inculqués, des besoins pour certaines marques et certains objets. L’individu, qui est censé pouvoir s’épanouir pleinement dans ces conditions, reste vide et désorienté.
Il ne doit pas prendre conscience de sa part dans la coopération réelle. Dans le domaine de la connaissance, plus la coopération et le partage deviennent faciles sur le plan technique, plus de nouveaux obstacles artificiels sont érigés pour les soumettre au contrôle des entreprises. Ce qui n’est en réalité qu’une pierre dans un bâtiment sur lequel des dizaines de générations ont travaillé devient ainsi la propriété privée d’individus. Pour pouvoir revendiquer de tels droits de propriété, il est nécessaire de faire disparaître la coopération, c’est-à-dire le caractère collectif du travail humain, derrière un écran de fumée.
« La société n’existe pas », affirmait Maggie Thatcher, prophétesse du néolibéralisme. Elle avait tort pour son époque. Mais pour notre époque, le danger est réel : les personnes qui sont privées de coopération finissent par être incapables de coopérer ; la société disparaît alors bel et bien. Il est regrettable que notre espèce ne puisse survivre avec la mentalité des primates.
Est-ce seulement mon imagination ? Non, notre société actuelle récompense les comportements psychopathiques, qui favorisent la carrière et sont une condition préalable à l’accès aux plus hautes sphères. Une étude récente a montré que le choix des études est déjà fait de telle manière que les psychopathes se retrouvent là où se trouve le pouvoir, à la tête des entreprises, tandis que les « normaux » végètent dans des postes moins bien rémunérés. Si l’argent et la possession sont la mesure ultime du succès, c’est la personnalité antisociale qui devient l’idéal.
« La suppression de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est la condition de son bonheur réel : la condition de renoncer aux illusions sur son état est la condition de renoncer à un état qui a besoin d’illusions. La critique de la religion est donc en germe la critique de la vallée de larmes dont la religion est l’auréole. » (Karl Marx)
Cette déshumanisation de la société actuelle est la raison pour laquelle la sécularisation qui s’opère ici me répugne profondément. Ce n’est pas l’idéal humain élevé au rang de valeur suprême qui est réalisé sur terre et dont la projection devient ainsi superflue. C’est une société anti-idéale qui doit détruire même la projection élevée au rang de valeur suprême.
Il n’y a plus d’idée d’un avenir meilleur, et le but du développement humain est l’égomane psychopathe ; une image si éloignée de la nature humaine qu’il faut encore en effacer le souvenir. Ce qui la remplace, ce mélange de déification du capital et de verbiage sur les valeurs, est tellement dénué de substance que le dernier sermon du dernier curé de village semble être une révélation intellectuelle. Un substitut d’un substitut, l’inverse de la dérivée seconde des conditions sans esprit, une simulation idéologique au niveau intellectuel d’un spot publicitaire, derrière laquelle se cachent un asservissement sans limites et une folie impérialiste effrénée. Je me demande parfois comment Marx réagirait s’il voyait l’état dans lequel se trouve aujourd’hui la société capitaliste. Dégoûté ? Horrifié ? Il dirait probablement que ce degré de pourriture est le résultat d’un passage trop long entre deux formations sociales, et il aurait raison.
La religion est devenue gênante pour les adeptes de Mammon ; si elle ne se vide pas suffisamment, si elle ne renonce pas à toute revendication sociale, à tout idéal humain, comme dans le takfirisme ou les églises télévisées américaines, elle ne fait qu’empêcher la formation de l’esclave/consommateur idéal. Mais pour tout changement réel, il faut une image contraire à l’existant, l’idée d’un autre monde, d’une autre vie, de tout ce qui est écarté sous le prétexte qu’« il n’y a pas d’alternative ». Soudain, je me sens plus proche des adeptes du christianisme que des adeptes du capital, car pour ces derniers, l’idée même d’humanité est un anathème, une apostasie de la vraie foi. En même temps, la résistance a besoin de l’idée du sacrifice pour gagner en force ; toutes les protestations branchées sur Internet qui ne heurtent pas l’idée de l’individualisme consumériste, qui n’exigent aucun sacrifice, ne sont que du vent, du divertissement, des jeux sans substance qui captent la contestation tout en la neutralisant. Un véritable changement nécessite l’attitude d’Ostrowski. De la persévérance, de la ténacité et la volonté de faire soi-même le sacrifice ultime.
« La critique a arraché les fleurs imaginaires de la chaîne, non pour que l’homme porte la chaîne sans imagination et sans consolation, mais pour qu’il jette la chaîne et brise la fleur vivante. (…) La critique de la religion aboutit à l’enseignement que l’homme est le bien suprême de l’homme, c’est-à-dire à l’impératif catégorique de renverser toutes les conditions dans lesquelles l’homme est un être avili, asservi, abandonné, méprisable, conditions qu’on ne saurait mieux décrire que par l’exclamation d’un Français à propos d’un projet de taxe sur les chiens : « Pauvres chiens ! On veut vous traiter comme des êtres humains. » (Karl Marx)